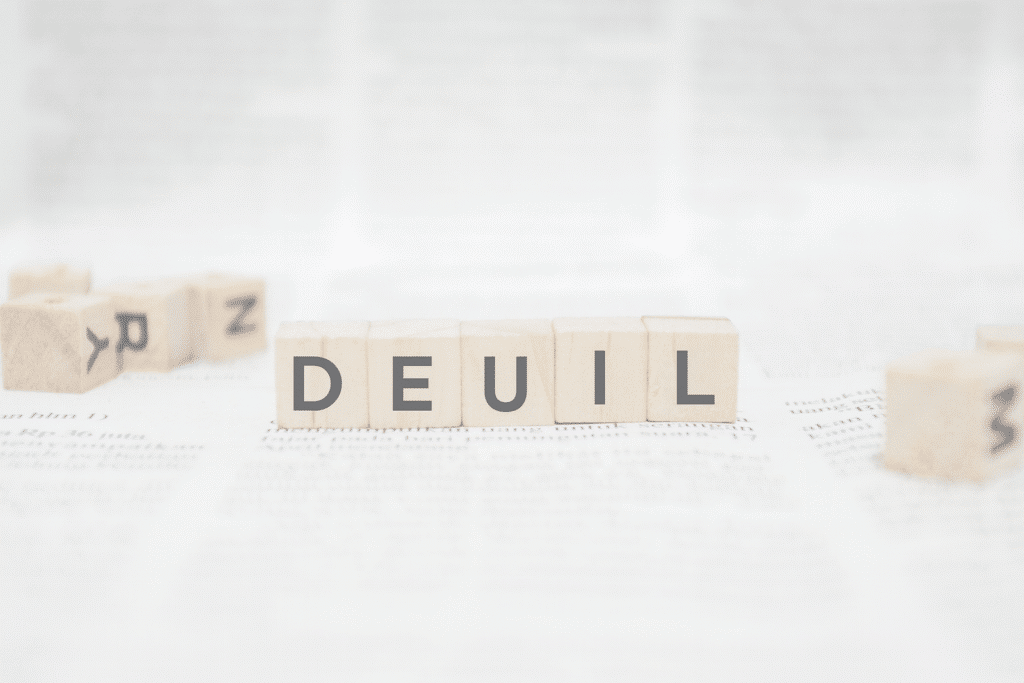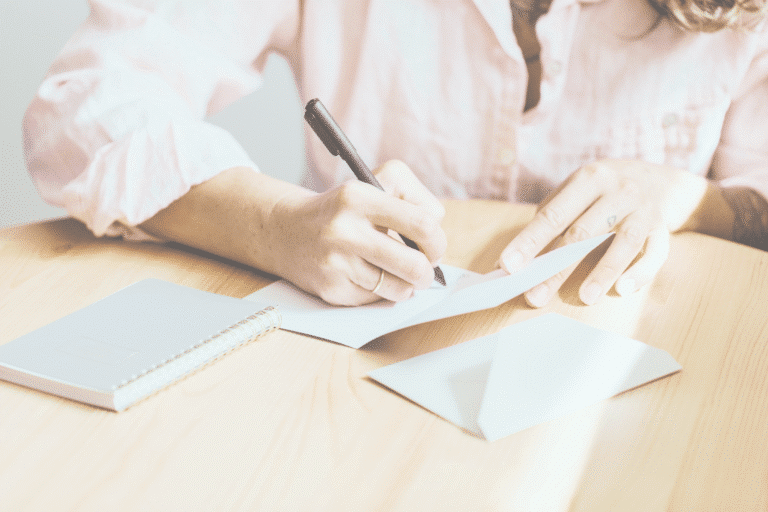Pourquoi le français n’a pas (encore) de verbe pour “deuil”
Un mot qui manque cruellement à la langue française
J’ai toujours aimé les mots et leurs origines. Pendant mes études supérieures, j’avais un professeur d’étymologie absolument fascinant. Il ne nous enseignait pas les mots comme de simples outils techniques, mais comme des témoins vivants de notre histoire collective. Grâce à lui, j’ai découvert que chaque terme porte une mémoire. Une mémoire parfois oubliée, mais jamais tout à fait perdue quand on s’y intéresse.
Je faisais alors enfin le lien entre le latin, le grec ancien que j’avais croisés un peu plus tôt, et même l’anglais que je perfectionnais en cours de traduction. Ce puzzle linguistique révélait que des mots très actuels — en français, en anglais et dans d’autres langues — avaient des racines communes. Des liens incroyables entre des mots venant de cultures différentes et transformés au fil du temps.
Et pourtant, certains manquent à l’appel. C’est précisément le cas du mot deuil.
L’absence d’un verbe pour dire le deuil : un vide significatif
Deuil est un mot lourd, chargé, silencieux aussi. On le dit, on l’écrit, mais en français, jamais on ne l’actionne.
Ces dernières années, je me suis souvent demandé : pourquoi le français n’a-t-il pas de verbe pour deuil ? Pourquoi ne pouvons-nous pas dire simplement je deuille, comme on dit je souffre, je pleure, j’aime ou je survis, je meurs… ?
Ce n’est pas juste une bizarrerie linguistique. C’est un vide. Un espace qu’on contourne, qu’on meuble avec des expressions souvent vagues, parfois maladroites et qui sèment la confusion.
Ce verbe que l’anglais a gardé, et que le français a perdu
Quand l’anglais dit “I’m grieving”
Quand on vit une perte, on cherche les mots pour le dire. Alors, on dit : j’ai perdu un proche. On parle de la personne, de l’événement, mais rarement de soi. On raconte la perte, mais pas toujours ce qu’elle fait en nous. Dire je suis en deuil reste rare. Peut-être parce que c’est une formule lourde, un peu solennelle, presque abstraite. Ou peut-être parce que notre langue, à cet endroit précis, ne sait pas trop comment se tenir.
En français, il manque donc ce verbe du deuil, ce mot-là.
En anglais, c’est plus direct : “I’m grieving”. Une émotion. Le verbe est là, simple.
Et surtout, un verbe actif : I grieve, I am grieving. On dit ici l’action de vivre la peine, on la met en mouvement. En français, nous parlons d’un état : être en deuil. C’est une formule plus passive, presque figée, qui constate la perte au lieu de la traverser.
Mais ce qu’on ignore, c’est que grieve vient de l’ancien français grever, qui voulait dire “accabler”. Et que ce mot-là provient lui-même du latin gravare – alourdir.
Une filiation de mots qui sont profondément liés à l’expérience humaine de la souffrance.
Le nom the grief, qui accompagne ce verbe en anglais, est d’ailleurs bien plus fort que notre mot chagrin qui semble lié à l’enfance. Il exprime une douleur profonde, éprouvante, une peine que rien ne console vraiment. C’est une tristesse lourde, dont seul le temps peut atténuer la densité.
Et le verbe to grieve, issu de cette même racine, porte toute cette intensité avec lui — sans détour, sans affaiblissement.
Quand le français contourne la douleur
Et nous alors ? On dit quoi en français aujourd’hui ?
Je fais mon deuil.
Je suis en deuil.
Je vis un deuil.
Des formules qui sonnent comme des détours. Qui évitent l’émotion brute, là où un vrai verbe pour dire le deuil apporterait clarté et justesse. Elles racontent l’état, mais pas le mouvement. Or, le deuil est en mouvement.
Le deuil se transforme et nous transforme.
“Faire son deuil” : une formule trop floue ? Une expression devenue injonction
“Faire son deuil” est aujourd’hui une formule omniprésente. On la retrouve dans les médias, les discours politiques, les conversations du quotidien. C’est une expression utile pour certains, étouffante pour d’autres. Tout dépend de la manière dont elle est entendue.
Mais est-ce vraiment un “faire” ? Est-ce un projet à mener, une étape à valider, un objectif à atteindre ? Rien n’est moins sûr.
Le problème, c’est que cette expression suggère une fin. Un moment où l’on aura “réussi” à tourner la page. Pourtant, le deuil n’est pas un processus linéaire. Il ne suit pas d’ordre. Il s’impose, il revient, il s’infiltre, parfois longtemps.
Pudeur culturelle ou faiblesse lexicale ?
Le français : une langue de retenue ?
Certains diront que la langue française préfère la suggestion à l’expression directe. Qu’elle valorise la pudeur. Peut-être. Mais face à la perte, cette discrétion devient parfois une forme de silence. Un silence que l’on pourrait prendre pour un tabou. Mais est-ce vraiment le cas ?
Sans verbe, on tourne autour de la douleur. On ne la dit pas telle qu’elle est. Cette absence de mot rend l’émotion floue. Parfois même incompréhensible. Invisible, aux yeux des autres comme aux nôtres.
Conclusion : Et si on inventait un verbe pour dire le deuil ?
Imaginer “deuiller” pour mieux vivre la perte
Un mot, ce n’est pas qu’une convention. C’est une façon de légitimer ce que l’on ressent. Et un verbe du deuil pourrait précisément donner une place légitime à cette expérience.
De dire : ce que je vis est réel, et j’ai le droit de le ressentir ainsi. Peut-être qu’il suffirait d’un mot. Un mot pour dire ce qu’on vit, ce qu’on ressent, ce qu’on traverse. Quelque chose comme :
Je deuille, tu deuilles, il/elle deuille
Un mot de plus, non pas pour guérir, ni pour tout expliquer. Juste pour être là, au bon endroit, au bon moment. Un mot qui ne ferait pas disparaître la douleur, mais qui l’accueillerait, la définirait en quelque sorte.
La langue évolue. Elle bouge. Elle s’adapte aux besoins. Si “deuiller” venait à être utilisé, écrit, partagé… il pourrait peut-être un jour faire son entrée dans notre dictionnaire collectif.